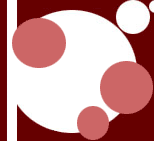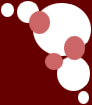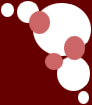Au théâtre, les éléments absurdes sont ainsi nommés lorsqu’on ne parvient
pas à les replacer dans leur contexte dramaturgique et scénique. Le théâtre de
l’après-guerre est le véhicule du théâtre absurde, ce qui en fait un mouvement à part entière. Par contre, nous retrouvons certains éléments absurdes dans d’autres mouvements antérieurs au théâtre
de l’après-guerre, notamment chez Aristophane, Plaute, la farce médiévale, la commedia dell’Arte et également
chez Jarry. C’est par contre Ionesco, avec La cantatrice chauve et Samuel Beckett avec En attendant Godot qui
font réellement naître ce genre.
La particularité du théâtre de l’absurde est qu’il porte une philosophie,
un langage derrière la risée. Il met en scène la dérision du monde dans lequel
on se trouve, dénué de toutes significations. Esslin, dans son essai, relie le
théâtre de l’absurde à l’existentialisme de Sartre, mais surtout avec Le
mythe de Sisyphe de Camus qui porte sur l’absurdité de l’être lui-même, d’un monde détruit par les conflits
idéologiques de l’après-guerre.
Il existe plusieurs stratégies de l’absurde. Tout d’abord, il y a l’absurde nihiliste. Dans ce genre, il est quasiment impossible de tirer des informations
sur la vision du monde et l’implication de l’auteur dans la philosophie de sa pièce. La plupart de pièces de Ionesco font partie de ce genre. Ce
n’est pas le cas pour Rhinocéros, par contre. Ensuite, il y a l’absurde
comme principe structural, qui reflète davantage le chaos universel et la désintégration
du langage. Rhinocéros fait davantage
partie de ce genre. Finalement, il y a l’absurde comme principe satirique, qui lui, rend compte d’une manière assez réaliste le monde qui y est dépeint. Aujourd’hui, le théâtre absurde est davantage nihiliste.